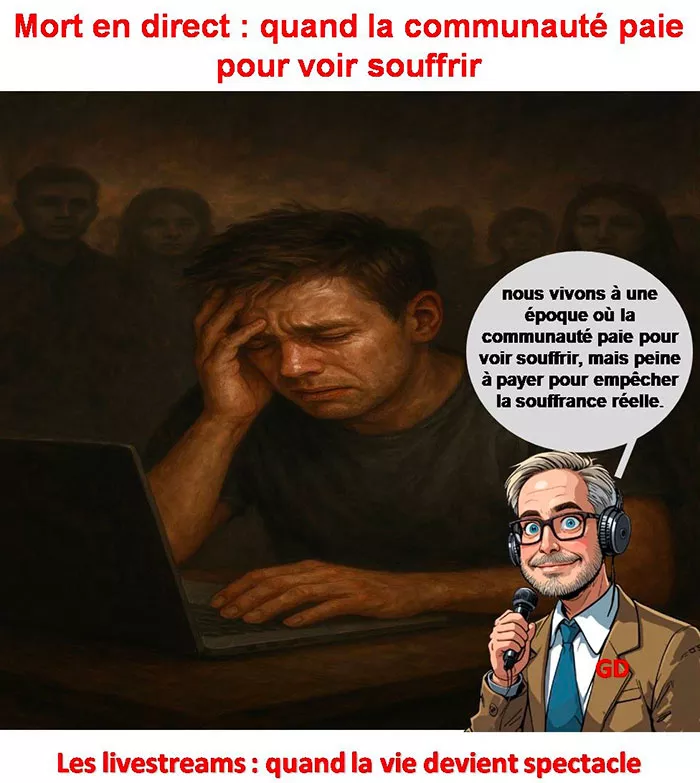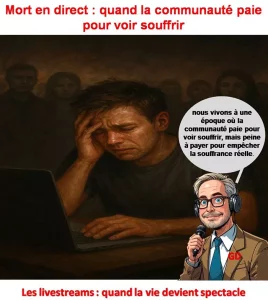Mort en direct : quand la communauté paie pour voir souffrir
Tout le monde est choqué, sidéré, un homme est mort en direct après des semaines de sévices consentis ( ?). Les réactions d’indignation, de colère, d’incompréhension se succèdent. Comme celle du président de la CUCM sur Facebook, et tant d’autres. La mort d’un être humain est un drame en dehors même des circonstances de sa mort.
Les faits ?
Jean Pormanove, 46 ans, streamer connu sur Internet, est mort dans la nuit du 17 au 18 août alors qu’il diffusait un marathon en direct. Ce drame, suivi en temps réel par des milliers de spectateurs et financé par leurs dons, dépasse le simple fait divers : il interroge la logique économique et psychologique du divertissement en ligne, où la souffrance humaine devient spectacle, et où la communauté paie pour la voir se produire.
Semaine après semaine, Jean Pormanove avait subi humiliations, défis dangereux et violences, encouragé par des spectateurs qui alimentaient son livestream de leurs dons. La mort de cet homme révèle une question plus large : pourquoi sommes-nous prêts à financer la souffrance d’autrui, alors que nous investissons si peu pour la prévenir dans le monde réel ? Les habitants du bassin minier connaissent parfaitement ce paradoxe, eux qui ont la solidarité et l’engagement dans leur ADN, c’est à cent lieues de leur vision des choses.
Les livestreams : quand la vie devient spectacle
Un livestream est une diffusion vidéo en direct sur Internet. Contrairement à la télévision, ces flux sont interactifs : les spectateurs commentent en temps réel, envoient des « dons » ou de l’argent aux créateurs, et influencent parfois directement le contenu.
Sur des plateformes comme Kick, ce modèle attire des millions de jeunes (souvent adolescents ou jeunes adultes) et repose sur une logique simple : plus c’est spectaculaire, plus l’audience grimpe, et plus les créateurs génèrent des revenus. Kick compte plusieurs millions d’abonnés et génère des centaines de millions de dollars par an grâce aux abonnements payants, aux micro-transactions et aux partenariats avec des sites de casinos en ligne. Les plus gros streamers peuvent gagner plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, alimentant un business de l’extrême où chaque défi dangereux devient monétisable.
Dans le cas de Jean Pormanove, cette logique a basculé dans l’horreur : son « contenu » reposait sur la répétition de défis dangereux, d’humiliations et de violences — dont il devenait la victime consentante, sous la pression économique et psychologique de son public.
La culture de la violence et de l’extrême
Le décès de Jean Pormanove met en lumière une culture de l’extrême qui prolifère en ligne : l’humiliation comme ressort de divertissement, la banalisation de la violence, et la logique de surenchère qui pousse toujours à aller plus loin.
Ce mécanisme, déjà visible dans certaines télé-réalités, atteint ici un point de non-retour car il se déroule sans encadrement et dans un environnement où la monétisation pousse à l’escalade.
La combinaison streaming + casinos en ligne intensifie le phénomène : certains sites partenaires de Kick brassent des centaines de millions de dollars par an, financés par des spectateurs souvent jeunes ou vulnérables. Chaque spectateur peut verser des dons illimités, sans plafond légal, et il n’existe pas de contrôle fiable de l’âge. Des cas de faillites personnelles liées à ces plateformes ont été recensés, mais restent ponctuels et peu médiatisés, sauf quand un scandale public éclate.
C’est la vie de tous les jours à bas bruit et dès que le volume sonore augmente, que des images apparaissent, on en reste totalement sidérés. La réalité est implacable et ineffaçable. Qui peut penser qu’il existe de telles choses, de telles pratiques et surtout de tels comportements ?
La communauté paie pour voir souffrir
Le cas Pormanove révèle une contradiction vertigineuse :
- En ligne, des milliers de spectateurs ont donné de l’argent pour financer l’humiliation et la souffrance d’un homme.
- Dans le monde réel, nos sociétés peinent à mobiliser des moyens équivalents pour prévenir la souffrance — pauvreté, santé mentale, guerres oubliées.
Il est plus facile aujourd’hui de récolter 5 000 euros en une soirée pour forcer quelqu’un à avaler des substances nocives en direct que de lever la même somme pour une mission humanitaire.
Qui paie ? Portrait des publics
Les dons révèlent plusieurs profils, pas de portraits types, ça diffuse dans toutes les couches sociales de la société, tous les âges, les deux sexes :
– Jeunes actifs précaires : étudiants, intérimaires, employés, qui donnent quelques euros pour « participer ».
– Spectateurs plus aisés : professions intermédiaires, cadres, capables de verser des sommes importantes pour influencer le live.
- Profils en quête de domination : une minorité qui paie pour « acheter » l’humiliation d’autrui et exercer une forme de contrôle.
Au final, la communauté devient co-auteure du drame : c’est elle qui finance, encourage et accélère la spirale.
De Rome à Internet : la souffrance comme spectacle
L’histoire humaine offre des précédents troublants.
- Dans la Rome antique, les foules acclamaient les gladiateurs ou décidaient du sort des condamnés.
- Jusqu’au XIXᵉ siècle, les exécutions publiques attiraient les masses, venues assister à la souffrance comme à une fête.
- Plus tard, les freak-shows et expositions coloniales faisaient de l’humiliation ou de la différence un objet de consommation.
- Même certaines téléréalités modernes ont joué sur la manipulation et l’humiliation pour séduire.
La nouveauté des livestreams est double :
– L’interactivité : le spectateur n’est plus passif, il agit en temps réel.
– La mondialisation numérique – le spectacle n’est plus local, mais planétaire.
Ainsi, le drame Pormanove s’inscrit dans une continuité anthropologique : l’humain fasciné par la souffrance de l’autre. Mais il révèle aussi une accélération inédite : chacun peut désormais, d’un clic, devenir acteur de cette souffrance.
Les implications économiques et politiques
– Économiques : un « business de l’extrême » rentable pour les plateformes, qui prélèvent leur commission et ferment les yeux. Les flux d’argent colossaux de Kick et des casinos en ligne rendent ce modèle difficile à réguler.
– Politiques : malgré des alertes répétées, l’Arcom et le gouvernement français sont accusés d’inaction, alors que des plateformes sans contrôle fiable d’âge ou de plafond de versement exposent des jeunes spectateurs à de forts risques financiers.
– Sociétales : l’affaire illustre une inversion de nos priorités : nous payons pour voir souffrir, mais investissons si peu pour soulager la souffrance réelle.
Réactions et hommages
– Clara Chappaz, ministre déléguée au Numérique, a dénoncé une « horreur absolue » et annoncé la saisie de l’Arcom.
– Sarah El Haïry, haut-commissaire à l’enfance, a rappelé les risques pour les plus jeunes.
– Sur les réseaux, les hommages sincères se mêlent à la culpabilité collective : « Comment avons-nous pu laisser faire ? »
Au-delà du fait divers : un miroir de nos contradictions
Ce drame est plus qu’un accident isolé. Il dit quelque chose de nous, de nos valeurs, de notre époque. Nous ne pouvons nous voiler la face.
– Humainement, il montre combien l’écran abolit l’empathie : on rit, on paie, on participe, sans voir la douleur réelle derrière l’image.
– Sociétalement, il révèle une société qui investit plus volontiers dans le spectacle de la souffrance que dans son soulagement.
– Religieusement, il s’oppose aux traditions spirituelles qui placent la compassion au centre. Ici, la logique est inversée : la souffrance devient une ressource, un produit.
– Philosophiquement, il pose la question de la liberté : Jean Pormanove a-t-il vraiment « choisi » cette voie, ou était-il piégé dans une spirale économique et psychologique ? Peut-on être libre quand sa dignité se monnaye ?
– Politiquement, il interroge l’absence de régulation et le retard des pouvoirs publics à protéger les plus vulnérables, alors même qu’ils se déclarent garants de l’ordre public.
La mort de Jean Pormanove est ainsi un révélateur : nous vivons à une époque où la communauté paie pour voir souffrir, mais peine à payer pour empêcher la souffrance réelle. Et tout cet argent dépensé pour ces buts inavouables ferait du bien partout ailleurs, on le sait partout en France, mais aussi et surtout dans le bassin minier où les besoins sont immenses.
Et c’est peut-être là, plus encore que dans le drame individuel, que réside la véritable tragédie collective.
Gilles Desnoix