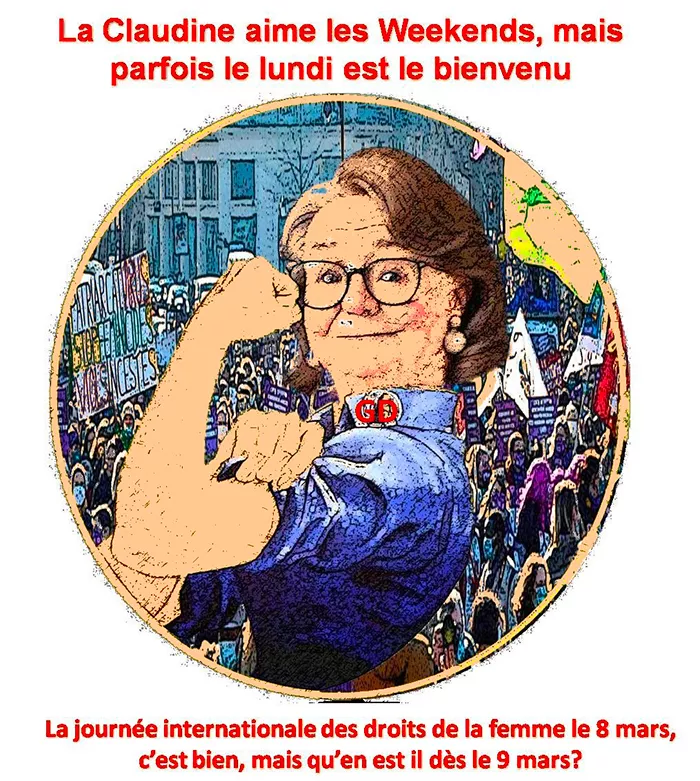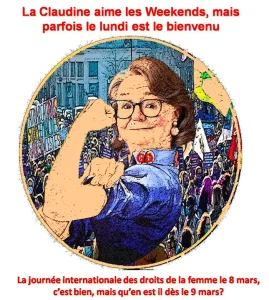La Claudine aime les week-ends, mais parfois le lundi est le bienvenu
Une journée dense en évènements, manifestations, cortèges, débats et autres dans tout l’hexagone, les DOM/TOM, l’Europe, le monde : le 8 mars. Nombre de personnes interviewées en microtrottoirs ne connaissent ni la vraie appellation, ni la signification de ce jour. Pire pour beaucoup, c’est « La journée de la femme » comme la Saint-Valentin, la fête des Mères, etc.
L’idée d’une date consacrée aux droits de la femme remonte au 28 février 1909, le (National Woman’s Day) « Journée nationale de la femme » répondant, aux États-Unis, à l’appel du Parti socialiste d’Amérique. En 1911, le 19 mars, célébration de la première « Journée internationale des femmes » par l’Internationale socialiste des femmes.
Des « journées internationales de la femme » ou « des ouvrières », de 1911 à 1915, trouvent leur célébration dans différents pays, particulièrement en Allemagne, en Autriche, en France et en Russie.
Le 8 mars 1914, à Berlin, a lieu une journée de revendication du droit de vote pour les femmes. Ce sont les femmes socialistes qui sont à l’initiative d’une grande partie des évènements se tenant ce jour-là. Si la date concorde avec celle de la journée internationale actuelle, le choix semble être dû au hasard. On parle là d’un droit en particulier, qui est tout de même fondateur de la majorité civique et politique des femmes : le droit de vote. Le slogan de cette journée est d’ailleurs « En avant avec le droit de vote aux femmes ! »
Il faut ensuite attendre 1921 pour que la Russie soviétique officialise cette journée comme un jour férié, mais non chômé. Le 11 novembre 1972, en Belgique, une Journée des femmes en Europe rassemble 8 000 femmes.
Du 19 juin au 2 juillet 1975, se tient à Mexico la première conférence mondiale sur les femmes. À l’ordre du jour, le projet d’année internationale de la femme, un programme des Nations unies intitulé la « décennie pour les femmes » (1976-1985), la rédaction de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, acceptée en 1980 à Copenhague.
Le 8 mars 1977, l’ONU adopte une résolution enjoignant à ses pays membres de célébrer une « Journée des Nations unies pour les droits des femmes et la paix internationale ».
Voilà pour un bref historique non exhaustif de la création de cette journée. Il s’agit d’un symbole de la lutte pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et donc pour l’érection intangible de leurs droits.
Donc, chaque année, le 8 mars, le monde se met en mode sanctification de la femme sans toujours faire référence ou expliquer en quoi cela concerne les droits des femmes, la parité, l’égalité et l’équité.
Mais la Claudine, après un weekend bien rempli d’activités sur ce thème dans tous les domaines, se dit, comme chaque année : « La journée internationale des droits de la femme le 8 mars, c’est bien, mais qu’en est-il dès le 9 mars ? »
Et la question se pose réellement.
Prenons le droit à disposer de son corps. La France a inscrit l’IVG dans la Constitution, mais l’exercice de ce droit n’est pas toujours évident, car des forces hostiles agissent au sein de la société française pour en restreindre l’usage. Ailleurs en Europe, les choses ne sont pas simples non plus.
Il y a quand même l’exemple encourageant de l’Espagne qui, le 18 juin 2024, par son tribunal constitutionnel, a validé la réforme du droit à l’avortement de 2022 prévoyant la possibilité pour les adolescentes de 16 et 17 ans d’interrompre leur grossesse sans le consentement de leurs parents. Mais nous avons vu comment les choses se sont passées dans les pays où les forces populistes de droite sont arrivées au pouvoir et les restrictions que cela a amenées en Europe. Sans parler des USA qui font marche arrière sur beaucoup de droits des femmes. Quant au reste du monde, souvent la situation est désespérante. L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes passe aussi par une justice exemplaire et donc un droit pénal adéquat. Les exemples de ces mois-ci en France, avec des procès retentissants et très médiatisés sur les violences sexuelles, pointent la nécessité d’aller encore plus loin dans la prévention, la formation des forces de police, de la magistrature spécialisée, dans l’attitude politique. C’est un fléau dans le monde entier et la Claudine se dit que dès le 9 mars tout repart comme avant et que l’on avance si lentement que dans un siècle on n’aura pas encore réglé le problème sur la planète. Et à l’heure actuelle, la suppression de la quasi-totalité des financements de programmes à l’étranger de l’USAID fait que près de 11 millions de femmes sont affectées par cet arrêt brutal de l’aide américaine et parmi elles, environ deux millions de femmes n’auront plus accès à la contraception, 10 000 femmes mourront par défaut de suivi de grossesse. Ce n’est pas la Claudine qui le dit, mais Jean-François Corty, président de Médecins du monde.
Si l’on se penche sur la fameuse égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce qui inclut aussi les parcours de carrières, le niveau de reconnaissance des compétences et la prise en compte de l’équité et de la parité tout autant que de l’égalité, on se rend compte qu’il y a eu certes des progressions, mais pas un renversement de la table. La Claudine l’a constaté toute sa vie. À égalité de diplôme, de compétences reconnues, elle n’a jamais gagné autant que ses collègues masculins. Collègues masculins jamais soumis à la double journée de travail comme elle et ses consœurs mères de famille. Collègues masculins qui ont pu obtenir une parfaite linéarité de carrière, car ils n’ont pas dû s’arrêter pour les congés maternité, passer à temps partiel, etc. À bien y regarder, la Claudine se dit que la situation en France est certes navrante, mais qu’il y a pire en Europe, dans le monde et même aux USA. Et elle se dit que c’est une des causes des mobilisations dans notre territoire ce 8 mars : défendre les acquis et les améliorer toujours. Dans le monde, la proportion de femmes dirigeantes de pays, de gouvernement, d’industries, etc. augmente peu à peu, mais là non plus, la parité est loin d’être advenue. Et ce n’est pas seulement la Claudine qui le dit.
Bien sûr, le fait d’être une femme ne garantit pas de mener une politique en faveur des droits des femmes, mais l’augmentation significative du nombre de femmes au pouvoir n’est pas anodine.
Il y a dans tout cela un problème d’éducation et d’instruction. Là aussi, les chiffres font peur à la Claudine : 129 millions de filles ne vont pas à l’école dans le monde. Si elles vivent dans des pays touchés par un conflit, les filles sont 2 fois plus privées de scolarité que leurs consœurs vivant dans un pays en paix.
Les causes sont multiples et souvent mêlées à la pauvreté, mais pas seulement : mariage d’enfants, religion, violence liée au genre, absence de valeur économique dans certaines cultures, priorité donnée aux garçons en termes d’éducation. Et même si elles peuvent recevoir un embryon de scolarité élémentaire, les études secondaires leur sont généralement refusées, difficiles à intégrer ou interdites.
L’Unicef mène une politique de collaboration avec les communautés, avec les gouvernements et avec ses partenaires pour lever les obstacles à l’éducation des filles et favoriser l’égalité des genres dans l’éducation. Et ce, dans des contextes souvent très complexes et surtout très impénétrables ou politiquement mouvants. La Claudine a vu que ce 8 mars 2025, à l’ECLA à Saint Vallier, Ville labellisée « ville amie des enfants », l’Unicef avait animé un atelier parents-enfants pour évoquer de manière ludique et adaptée aux enfants les droits des filles dans le monde et parler de la convention internationale des droits des enfants.
Il y a quand même de l’espoir, s’est dit la Claudine, même s’il est si mince que l’on a peur qu’il s’évapore.
Du coup, le lundi matin, la Claudine se dit, comme chaque année, avec juste un soupçon d’espoir en plus : « Mais qu’en est-il dès ce 9 mars ? »
Gilles Desnoix