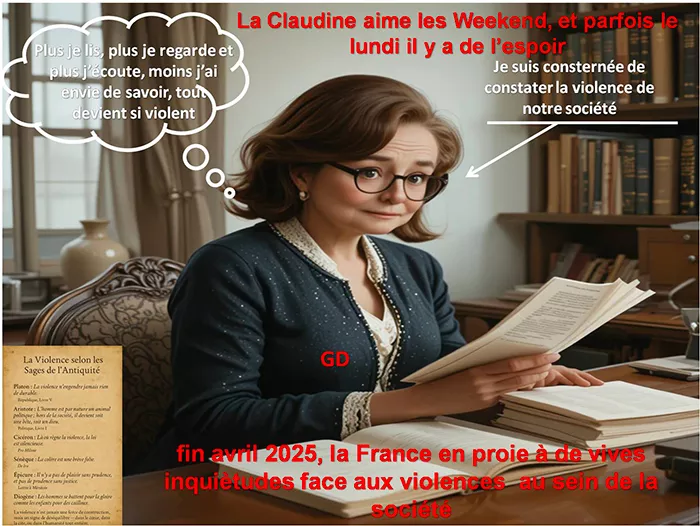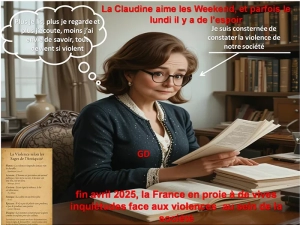La Claudine aime les week-ends, et parfois le lundi il y a de l’espoir.
Il n’est pas un jour, pas une heure, sans sa rubrique violente. La Claudine a passé une mauvaise semaine avec cette antienne dans les oreilles. Violence dans le monde, en Ukraine, attentats en Iran ou au Cachemire, au Canada, à Gaza où, depuis mars 2025, l’armée israélienne intensifie ses bombardements en rupture avec un précédent cessez-le-feu. Au 25 avril, on dénombre au moins 2 062 morts et près de 5 000 blessés ; violences en France tous azimuts. Il est vrai qu’arrivée à un certain stade de sa vie, la Claudine devient de plus en plus sensible au contexte, à ce qu’elle percevait autrement avant. Ce qui a changé aussi, c’est l’intrusion dans la vie des gens des chaines d’info en continu, le développement exponentiel des réseaux sociaux et l’absence dans ces nouveaux médias d’un réel recul face aux évènements, ce qui emporte une dictature de l’immédiateté et de l’assignation à être réactif, pour ou contre, mais pas neutre. Pour beaucoup de gens, se trouver ainsi, de façon indistincte, sans médiation directe, confrontés, par l’image et le son, à plusieurs formes de violences, sans compter celle des polémiques qui en découlent, suscite une vive inquiétude qui pèse sur leur moral, leur quotidien et parfois leur santé mentale. La Claudine n’échappe pas au phénomène, même si elle raisonne et se raisonne.
C’est que, dans le panorama quotidien des violences, il s’est mis en place un panel des préoccupations principales actuelles :
– les violences en milieu scolaire : le 24 avril, une attaque au couteau, par un élève de 15 ans, dans un lycée privé de Nantes a coûté la vie à une élève de 15 ans et blessé trois autres. Il s’agit du dernier événement en date ; il y en a eu d’autres avant et l’on s’attend à ce qu’il y en ait d’autres ensuite. Cela relance le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires, alors que les signalements d’armes blanches en milieu scolaire ont augmenté de 15 % en un an. Et puis, il y a l’affaire Bétharram et ses diverses répercussions.
– les violences intrafamiliales et féminicides : la dernière en date, l’affaire de Perrine, 41 ans, le 13 avril, battue à mort à son domicile de Champigny-sur-Marne par son conjoint. Rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour ne pas avoir protégé trois mineures ayant dénoncé des viols.
– les violences dans le secteur culturel : suite à la commission d’enquête, le rapport parlementaire publié le 9 avril révèle des violences systémiques dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant, notamment des abus de pouvoir, du harcèlement et des agressions sexuelles.
– les violences dans les stades : qui perdurent, s’amplifient sous diverses formes au travers d’une série d’incidents récents. 202 interdictions de stade sont actives en France. Les autorités disposent, d’après leurs conclusions, d’une marge de progression importante pour assurer la sécurité lors des événements sportifs. De son côté, le gouvernement a annoncé des mesures pour lutter contre les violences dans les stades. D’après une grande majorité de commentateurs, cela ne va ni assez loin ni assez en profondeur : les intérêts en jeu, dont le poids financier, sont trop énormes pour que l’on agisse réellement en profondeur et de manière drastique.
– l’évolution de la criminalité : celle-ci a été quantifiée au travers d’indicateurs repris dans le rapport Interstats Conjoncture d’avril 2025. Si la majorité des indicateurs de criminalité sont en baisse, notamment les vols dans les véhicules (–9 %) et les vols violents sans arme (–5 %), une hausse est observée pour les violences sexuelles (+6 %) et le trafic de stupéfiants (+7 %). Et ce dernier point renvoie aux scènes de violences avec meurtres et assassinats de sang-froid devant tout le monde, aux tirs aveugles contre les façades, en pleine rue sans égard aux paisibles passants, avec des morts et des blessés sans lien avec le milieu du banditisme. Quand ce dernier fait payer l’addition aux habitants sans aucun scrupule et sans état d’âme.
– les attaques contre des prisons françaises : cela amplifie le ressenti vis-à-vis d’une part d’une progression de la délinquance armée, mais aussi la défiance vis-à-vis des autorités devant assurer notre tranquillité : police et justice. Depuis le 13 avril, à travers le pays, des établissements pénitentiaires sont visés par une série d’attaques coordonnées, accompagnées d’incendies de véhicules, de tirs d’armes automatiques et d’actes d’intimidation. Le « DDPF », un groupe mystérieux inconnu que les chroniqueurs télévisuels ou de la presse écrite dénoncent soit comme d’extrême droite, soit comme d’ultra gauche, revendique ces attaques avec des justifications que le commun des auditeurs ou des lecteurs a bien du mal à comprendre. Cela aussi renforce le sentiment d’insécurité, de malaise que la Claudine ressent très fortement.
La Claudine recherche tous azimuts des informations, des éléments de compréhension. Elle a lu Par-delà le principe de répression, l’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie. Reprenant, analysant et synthétisant les actes de ses conférences sur l’abolitionnisme pénal, il développe une critique du « punitivisme » fondé sur la répression et l’incarcération et élabore un positionnement remettant en cause de manière radicale les institutions pénales actuelles. Un débat devrait s’ouvrir autour de cette thèse et de celles qui lui sont opposées, mais l’on préfère discuter à perte de vue avec des arguments qui sont souvent éloignés de la réalité des faits et des concepts.
À Lyon, l’université Lumière Lyon 2 a organisé le 11 avril une journée interdisciplinaire intitulée Pensée clinique et politique des violences de masse. Au cœur des interventions se sont trouvé les mécanismes psychologiques et sociaux menant à la déshumanisation et à la banalisation du mal, en s’appuyant notamment sur les travaux d’Hannah Arendt. Il s’est agi d’une approche croisant psychanalyse, anthropologie et criminologie aux fins d’analyse des processus de radicalisation et de violence extrême. Absolument fascinant, mais aussi très anxiogène, pour les béotiens, par ce que les interventions mettent en lumière.
L’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) n’est pas en reste avec un colloque sur les intellectuels face à la violence. Ce dernier s’est tenu du 9 au 11 avril, il avait pour titre Les mots et la violence. Il réunissait un ensemble d’intellectuels afin de discuter du rôle des intellectuels littéraires en période de dictature. La responsabilité des écrivains et des traducteurs face à la censure et à la terreur, ainsi que leur engagement ou leur passivité dans des contextes de violence politique, ont été au cœur des débats.
Géopolitique et religions se retrouvent souvent au Collège des Bernardins : le 7 avril s’est tenue, dans le cadre du cycle Guerre et Paix, une conférence sur le thème Dans un monde en guerre, quelle paix le christianisme promet-il ? Il s’agissait d’explorer la promesse chrétienne de paix face aux crises géopolitiques actuelles, en interrogeant les fondements spirituels de la non-violence et de la réconciliation. Même les non-chrétiens, les non-pratiquants pouvaient y trouver des pistes de réflexion.
À Montpellier, le 26 avril, une conférence intitulée Sur Autrui : vers une éthique de la communication a été animée par le philosophe Éric Bastardie et l’humaniste Philippe Rajosefa. Le but étant d’élaborer une communication coopérative et non violente dans les interactions sociales.
L’université de Poitiers, elle, a organisé, le 20 mars, des conférences-débats Violence et politique. Elle a proposé une réflexion sur la représentation de la violence politique à l’opéra depuis 1945. Une intervenante, la musicologue Cécile Auzolle, a passionné le public avec une analyse qui démontre comment les œuvres lyriques ont mis en scène les tensions et les conflits politiques, offrant ainsi une lecture artistique des violences de l’histoire contemporaine.
Bien entendu, la Claudine se rend bien compte que l’ensemble de tout ceci témoigne d’une volonté croissante de comprendre et de questionner les différentes formes de violence qui traversent nos sociétés, en mobilisant des approches pluridisciplinaires et en interrogeant les responsabilités individuelles et collectives. Elle n’est pas dupe, cela n’infuse pas au niveau de la population qui n’a pas accès à ces événements dont la presse, la télévision ne parlent pas et ne présentent pas en contrepoint aux logorrhées de ses spécialistes, chroniqueurs et autres experts.
Elle a conscience qu’en avril 2025, face à une recrudescence de violences en France, les responsables politiques ont multiplié les annonces et initiatives pour y répondre. Réponse sécuritaire renforcée, durcissement des sanctions, plan d’action gouvernemental, plan interministériel renforcé, concertation nationale lancée, autant d’annonces, de grands discours qui traduisent une volonté politique de répondre aux différentes formes de violence qui touchent la société française. Mais, depuis tant d’années, tant de gouvernements, tant de ministres se succédant, la Claudine voit sa capacité de confiance s’élimer. Et pourtant, elle aimerait y croire.
Elle se rappelle ses lectures de lycéenne et d’étudiante. Platon : la violence n’engendre jamais rien de durable ; Aristote : l’homme est par nature un animal politique : hors de la société, il devient soit une bête soit un dieu ; Cicéron : là où règne la violence, la loi est silencieuse.
Oui, le lundi et la reprise des activités habituelles est la bienvenue, le week-end a été maussade.
Gilles Desnoix